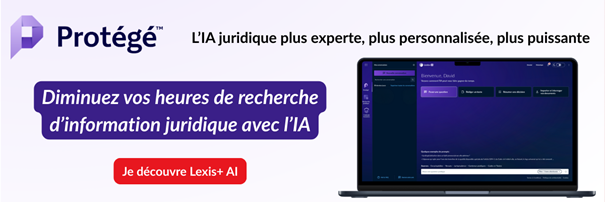07 Oct 2025
3 Questions - IA aux défis du droit : 29 propositions
Fruit d’une réflexion collective au sein de la commission Numérique & Justice de Paris Place de Droit, le Livre Blanc « IA aux défis du droit », édité par LexisNexis, apporte, d’une part, une analyse très concrète des enjeux posés par cette technologie et propose, d’autre part, une feuille de route autour de 29 recommandations. Objectif : faire de l’Europe - et de Paris - une puissance mondiale de droit dans l’ère de l’intelligence artificielle.
Quels sont les enjeux et les incidences de l’IA générative sur les métiers du droit ?
L’IA générative est une technologie à fort potentiel mais aux effets ambivalents. Elle n’est pas qu’un défi technique dans la mesure où elle met en lumière les forces et les fragilités de nos modèles économiques et juridiques.
Ses effets se font déjà sentir sur les métiers du droit à travers l’automatisation de la re[1]vue documentaire, l’analyse jurisprudentielle, la génération d’ébauches contractuelles… Utilisés avec discernement, ces outils peuvent renforcer l’efficience et l’accessibilité du droit, réduire l’asymétrie d’information et faciliter l’accès à la justice. Mais ils exigent une montée en compétence technique, éthique et déontologique des professionnels. Car l’interprétation, l’argumentation et la responsabilité restent profondément humaines.
Nous voyons d’ailleurs avec satisfaction que nos recommandations trouvent déjà des échos dans l’actualité récente. L’annonce du partenariat stratégique entre le géant néerlandais du numérique ASML et la pépite française Mistral illustre la prise de conscience nécessaire de l’importance de construire une autonomie technologique en Europe.
Les défis restent néanmoins de taille dans la réduction de la dépendance de l’Europe aux infrastructures américaines et chinoises ou encore dans l’importance des zones grises à combler en matière de discrimination algorithmique ou d’atteinte à la vie privée. Mais contrairement aux États[1]Unis (approche de marché) et à la Chine (contrôle étatique), l’Europe trace une voie originale avec une régulation éthique et préventive, ex ante, qui peut devenir un véritable levier de compétitivité si elle est appliquée avec proportionnalité.
Le gouvernement français nous semble l’avoir entendu au regard du schéma de gouvernance national pour le règlement européen sur l’intelligence artificielle qu’il vient de publier. La DGCCRF s’y voit attribuer un rôle central en coordonnant, en lien avec la Direction générale des entreprises, l’action des autorités de surveillance sectorielles françaises. Cela devrait permettre de veiller à ce que les obligations et interdictions prévues par le règlement IA (RIA) soient correctement appliquées dans les différents secteurs. Ce dispositif, reposant sur la désignation des autorités déjà compétentes selon leur domaine (finance, santé, biens de consommation…) et avec l’appui technique de l’ANSSI et du Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN), devrait pouvoir combiner crédibilité, efficacité et réactivité.
Quelles recommandations faites-vous en matière de régulation et de souveraineté ?
Le choix fait de mobiliser la DGCCRF montre que les préoccupations que nous avons formulées sont entendues. Nous militons, en effet, en faveur d’une gouvernance claire, d’une coordination entre les autorités, d’un recours aux expertises existantes et d’une supervision forte pour assurer la conformité dans tous les secteurs. L’intégration de la DGCCRF dans cette fonction de coordination nous semble traduire une volonté de responsabiliser les acteurs publics, de renforcer la confiance des citoyens et d’assurer que les protections au niveau national ne soient pas fragmentées. En outre, ce schéma permet d’ancrer la France dans une dynamique européenne forte : en jouant un rôle de représentation, la DGCCRF peut influencer les pratiques de surveillance au niveau de l’Union européenne, s’assurer que les orientations européennes soient traduites efficacement sur le terrain français et veiller à ce que les spécificités nationales (sectorielles, tech[1]niques et réglementaires) soient bien prises en compte.
Dans notre rapport, nous insistons sur trois principes : cohérence, proportionna[1]lité et légitimité démocratique.
- Cohérence : éviter la superposition du RIA et du RGPD, en coordonnant les autorités existantes au sein d’un Bureau national de l’IA chargé d’assurer la conformité, de clarifier les responsabilités et de sanctionner les pratiques déloyales.
- Proportionnalité : garantir un accompagnement spécifique aux PME, tout en imposant aux grandes plateformes des obligations renforcées de transparence et de loyauté.
- Légitimité démocratique : la régulation de l’IA n’est pas qu’une affaire d’experts. Elle doit être débattue publiquement pour fonder une confiance collective.
Nous nous réjouissons de constater que plusieurs autres initiatives récentes convergent dans le même sens avec : le rapport de l’Institut de la souveraineté numérique ou encore celui du Haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) sur les impacts de l’IA en droit financier.
La souveraineté européenne suppose enfin de transformer la régulation en puissance normative. Comme le RGPD l’a montré, l’Europe peut imposer ses standards à l’échelle internationale. Cela suppose de veiller à ce que les partenariats technologiques renforcent notre écosystème plutôt que de l’affaiblir.
Que préconisez-vous en matière d’investissements et de mobilisation de la part des acteurs du droit ?
L’investissement doit être à la fois financier, humain et institutionnel :
- financier, avec une stratégie ambitieuse autour des fonds européens, des partenariats public-privé et du soutien aux jeunes entreprises innovantes ;
- humain, en intégrant une formation spécifique à l’IA dans les cursus juridiques et en dotant chaque juridiction de juges spécialisés dans les contentieux émergents ;
- institutionnel, en adaptant les règles déontologiques aux principes de transparence, de contrôle humain et de gouvernance des données, et en réaffirmant la responsabilité pleine et entière des professionnels du droit.
Nous proposons aussi la création d’un observatoire européen de l’IA et du droit, chargé d’évaluer en continu les impacts réels des technologies, de recenser les bonnes pratiques sectorielles et de publier des recommandations régulières.
Nous constatons là aussi avec satisfaction que le débat avance dans ce sens. Le rapport de l’HCJP souligne déjà l’émergence de nouveaux contentieux, notamment en matière financière, et l’US Geological Survey a récemment cartographié les minerais nécessaires à l’essor des data centers, ce qui rap[1]pelle que les investissements doivent aussi tenir compte des enjeux ESG et de durabilité.
Enfin, l’Europe doit investir dans des espaces souverains de stockage de données juridiques et dans des modèles entraînés sur le droit continental. C’est à ce prix que nous pourrons concilier compétitivité, souveraineté et valeurs démocratiques.
NDA : ces propositions sont celles de la Commission Numérique & Justice de Paris place de droit dont les auteurs sont co-responsables.