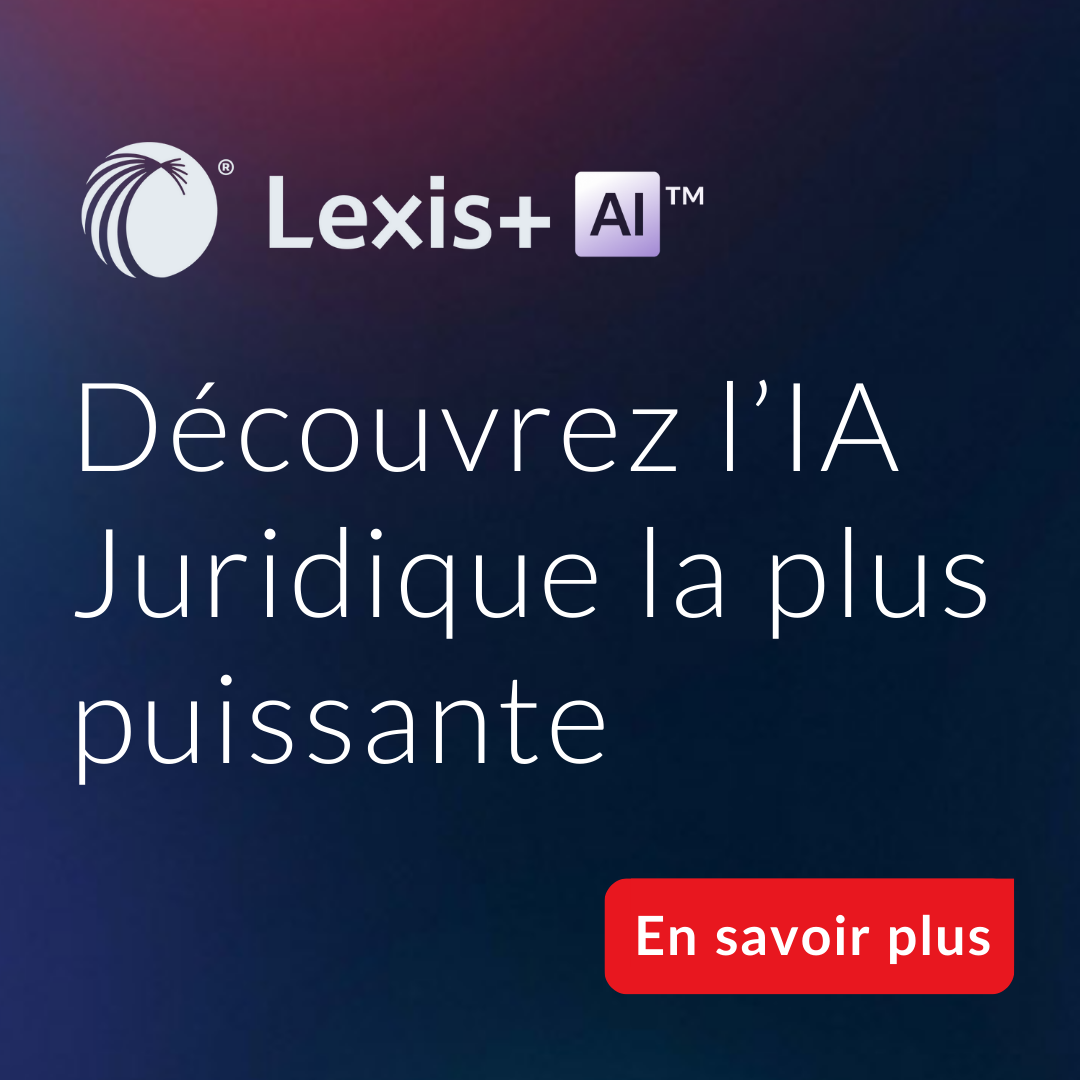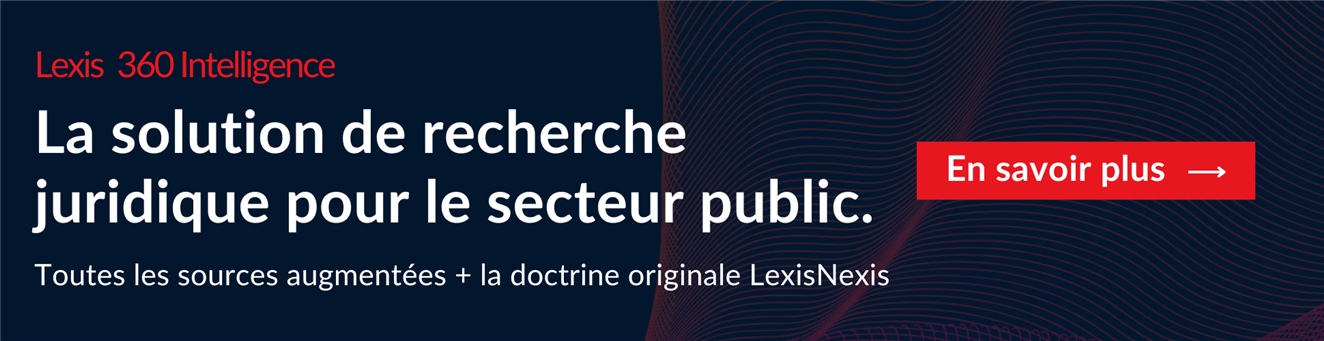Lexis 360 Secteur Public vous propose de télécharger la fiche pratique : « Protéger le lanceur d’alerte dans la fonction publique» Les fiches pratiques dans Lexis 360 Intelligence Secteur Public constituent...
Éléments clés Une délégation de service public (DSP) est un contrat conclu par « des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics [qui] peuvent confier la gestion d...
La Protection Juridique du Domaine Public Routier : Une Double Compétence Juridictionnelle Le domaine public est le support des activités d’intérêt général des personnes publiques. À ce titre, il est...
EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES N° 17. 27 AVRIL 2020 L'institution dans la tourmente de la crise sanitaire POINTS CLÉS ➤ « Organe de...
Lexis 360 Collectivités Territoriales vous propose de télécharger la fiche pratique n° 314 « Rédiger une délibération et un arrêté » Les 3 000 modèles d’actes Litec et les 1 4 000 fascicules de formules...

Lexis 360 Secteur Public vous propose de télécharger la fiche pratique N° 125 – Définir les besoins de la personne publique
Avec plus de 1300 fiches pratiques, Lexis 360 Secteur Public propose un nouveau contenu éditorial permettant d’obtenir des réponses opérationnelles. Découvrez un exemple de téléchargeable et imprimable de fiche pratique et de synthèse
N° 125 – Définir les besoins de la personne publique
1. Éléments clés
Les marchés publics sont des contrats conclus pour répondre aux besoins de l’acheteur public en matière de travaux, de fournitures ou de services (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 4), la notion de besoin correspondant à l’objet du contrat.
Par « besoins de la personne publique », on entend les besoins liés :
- au fonctionnement en propre de la personne publique (par ex. : achats de fournitures de bureaux) ;
- aux activités d’intérêt général qu’assure la personne publique et qui la conduisent à fournir des prestations à des tiers (par ex. : marchés de transports scolaires).
L’étendue et la nature de ces besoins doivent être définies précisément par la personne publique, préalablement au lancement de la procédure de passation du marché (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 30).
Par ailleurs, il est imposé au pouvoir adjudicateur de tenir compte des préoccupations de développement durable (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 30) : au moment de la définition de ses besoins, la personne publique doit concilier des objectifs de protection et de mise en valeur de l’environnement, de développement économique et de progrès social (CE, 23 nov. 2011, n° 351570 : JurisData n° 2011-026009).
Aux termes des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
La personne publique doit pouvoir justifier, auprès des organismes de contrôle (contrôle de légalité et chambre régionale des comptes pour les collectivités territoriales), l’absence de ces objectifs dans le marché (V. Rép. Min. à question écrite n° 251 : JO Sénat 11 janv. 2007). Le pouvoir adjudicateur peut utiliser le rapport de présentation prévu à l’article 105 du décret n ° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour justifier sa décision de ne pas prendre en compte tel ou tel objectif dans le marché. La personne publique peut recourir à des études préalables ayant pour objet de lui permettre d’évaluer les volumes et les coûts, ainsi que le périmètre et la nature de prestations nécessaires à la satisfaction de ses besoins.
La définition de ces derniers permet la rédaction des documents de consultation (description des spécifications techniques, variantes, critères de choix des candidats et des offres, conditions d’exécution du marché) et de choisir une procédure de passation.
La personne publique doit également les programmer afin d’éviter de recourir à des achats précipités. Il existe d’ailleurs des procédures destinées à offrir à la personne publique une certaine souplesse : il s’agit des marchés fractionnés (accords-cadres, marchés à bons de commande ou marchés à tranches conditionnelles)
2. Textes
2.1. Textes codifiés (abrogés au 1er avril 2016)
CMP, art. 1 (champ d’application et principes fondamentaux) et 4 (pour les besoins spécifiques à certains marchés de la défense)- CMP, art. 5 (détermination des besoins à satisfaire)
- CMP, art. 6 (spécifications techniques)
- CMP, art 79 (rapport de présentation établi par le pouvoir adjudicateur à l’achèvement de la procédure)
2.2. Textes non codifiés
n° 2015-899, 23 juill. 2015, relative aux marchés publics, notamment :-
- 4 (définition des marchés publics)
- 30 et 31 (définition préalable des besoins)
- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 , relatif aux marchés publics, notamment :
-
- 4 (études et échanges préalables avec les opérateurs économiques)
- 5 (participation d’un opérateur économique à la préparation du marché public)
- 6 à 11 (spécifications techniques, labels, rapport d’essai, certification et autres moyens de preuves)
- 20 à 23 (calcul de la valeur estimée du besoin)
- intermin., 14 févr. 2012 (guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics)
- 28 août 2006 (Spécifications techniques)
3. Bibliothèque LexisNexis
3.1. Fiches pratiques
Fiche pratique n° 346 : Utiliser la procédure de dialogue compétitif, par J.-M. Communier- Fiche pratique n° 347 : Réaliser un avenant, par J.-M. Communier
- Fiche pratique n° 287 : Recourir aux accords-cadres et aux marchés subséquents, par A.-E. Rubio et Éric Nigri
3.2. Fascicules JurisClasseur
Contrats et Marchés publics, Fasc. 51, Besoins de la personne publique. – Allotissement, par A. Alonso Garcia et A. Maillard- Contrats et Marchés publics, Fasc. 56, Avenants et prestations complémentaires, par B. Roman-Sequense, actualisé par M. Amilhat
3.3. Fascicules de synthèse
Contrats et Marchés publics, Synthèse 40, Règles générales de passation, par S. Braconnier et E. Kalnins
3.4. Revues
Llorens et P. Soler-Couteaux, Besoins du pouvoir adjudicateur et intérêt économique direct : où en est-on des critères des marchés publics ? : Contrats-Marchés publ. 2013, repère 11- Llorens, Illégalité d’un marché ne répondant pas aux besoins de la personne publique parce qu’excédant ses compétences : Contrats-Marchés publ. 2008, comm. 281
- Llorens, Football et marchés publics : le département du Rhône manque encore son but : Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 164.
- Zimmer, Estimation des besoins : Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 196;
- Zimmer, Détermination préalable des besoins : Contrats-Marchés publ. 2012, comm. 42
- Eckert, Définition préalable des besoins : Contrats-Marchés publ. 2013, comm. 67
3.5. Codes et ouvrages
Llorens et P. Soler-Couteaux, Code des marchés publics, édition commentée : LexisNexis, 6e éd., 2013.
Préparation
Informations préalables
1.1 Informations relatives au niveau de connaissance par la personne publique de ses besoins
Le conseil doit se renseigner sur le niveau de connaissance de ses besoins qu’a la personne publique :
- dispose-t-elle de suffisamment d’informations sur ses besoins ainsi que sur ceux des utilisateurs ? :
-
- connaît-elle les besoins des utilisateurs, et y a-t-il pour cela une analyse des besoins fonctionnels sur la base, par exemple, d’états de consommation ?
- a-t-elle mis en place une procédure standardisée d’expression de ses besoins (élaboration de fiches d’expression des besoins pour les fournitures courantes) ?
- dispose-t-elle de données suffisantes sur les fournisseurs du secteur ? :
-
- connaît-elle bien les marchés sur lesquels opèrent ses fournisseurs, et notamment le degré de concurrence dans ce secteur (très ouverte, oligopole, monopole) ?
- sa demande est-elle réaliste ?
- anticipe-t-elle le nombre d’entreprises susceptibles de répondre à son besoin ?
- peut-elle anticiper le montant, même approximatif de son achat ?
-
- a-t-elle une connaissance des prix planchers et des prix plafonds pratiqués par les entreprises susceptibles de répondre à son besoin ?
- a-t-elle mis en place un outil de veille sur les prix des achats ?
1.2. Informations relatives à la nature et au caractère fonctionnel des besoins
Par ailleurs, le conseil pourra interroger son client personne publique sur :
- l’usage auquel est destiné le service, le matériel ou la fourniture, avec une réflexion sur :
-
- le niveau de qualité ou de sécurité attendu,
- le lieu et la fréquence d’utilisation du service, matériel ou fourniture (y-a-t-il une incertitude sur la durée ?) ;
- les quantités prévisibles nécessaires (y-a-t-il une incertitude sur les quantités ?).
Attention : Les contraintes (qualité, fréquence d’utilisation, etc.) du produit attendu doivent être déterminées par l’acheteur public, éventuellement éclairé par des spécialistes indépendants. Mais cette détermination ne doit pas être confiée aux entreprises soumissionnaires.
Remarque : S’il existe des incertitudes (durée, quantité), le conseil doit penser à proposer à la personne publique de recourir alternativement à :
- un marché à tranches optionnelles ( n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 77) ;
- un accord-cadre donnant lieu à la conclusion de marchés subséquents ou à l’émission de bons de commande ( n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 78 à 80) ;
1.3. Informations relatives aux caractéristiques du marché
Le conseil devra enfin se rapprocher de son client, personne publique, afin de déterminer si le client a défini avec précision :
- l’objet du marché ;
- le mode de passation du marché (marché à procédure adaptée, appel d’offres, marché négocié, autre) ;
- la forme du marché (marché ordinaire ou marché fractionné) ;
- les modes de dévolution du marché (entreprises générales, entreprises groupées, lots séparés – l’allotissement est en principe la règle et est censé favoriser l’accès à l’achat public des petites et moyennes entreprises) ;
- un calendrier de consultation ;
- le mode de fixation du prix (prix unitaire, prix forfaitaire) ;
- les formules de révision du prix (actualisation, révision) ;
- les critères de sélection des candidatures et des offres ;
- le montant prévisionnel du marché.
Attention : Du montant prévisionnel du marché dépend :
- d’une part, la possibilité pour la personne publique de recourir à la procédure négociée à la suite d’un appel d’offres infructueux (V. Fiche technique DAJ Conseil aux acheteurs, La déclaration d’infructuosité, mise à jour le 21 fév. 2013) ;
- d’autre part, la possibilité de juger sur un critère financier les offres qui lui seront faites.
2. Inventaire des solutions et éléments de décision
2.1. Procédures conseillées en cas de difficultés de la personne publique à définir ses besoins
En présence de telles difficultés, le conseil peut suggérer à son client de recourir à plusieurs types de procédure, qui ont précisément pour objet de l’aider à déterminer ses besoins.
2.1.1. En cas d’incertitude portant sur les objectifs à atteindre et les moyens d’y parvenir
La personne publique peut recourir à une procédure de dialogue compétitif, lorsqu’elle n’est objectivement pas en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques permettant de satisfaire ses besoins ou d’établir le montage juridique ou financier d’un projet (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 75 et 76).
Attention : Les marchés de définition, qui permettaient d’examiner les possibilités et conditions d’établissement d’un marché ultérieur, ne constituent plus une solution envisageable (CMP, anc. art. 73 . – abrogé par le décret n° 2010-406, 26 avr. 2010).
2.1.2. En cas d’incertitude portant sur l’étendue des besoins à satisfaire
La personne publique peut recourir au marché fractionné lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme et l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché.
Ce marché fractionné peut par exemple être un marché à bons de commande dans lequel, le pouvoir adjudicateur est libre : soit de fixer un montant minimum et un montant maximum (en valeur ou en quantité) ; soit de ne prévoir qu’un montant minimum ou qu’un montant maximum ; soit de conclure le marché sans minimum ni maximum (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 78 II).
Attention : Dans le cas d’un marché à bons de commande, il était possible de recourir, pour des besoins occasionnels de faible montant, à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, et ce, pour autant que le montant cumulé de ces achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 euros hors taxes (HT). Le recours à cette faculté ne pouvait dispenser le pouvoir adjudicateur de son engagement à commander un minimum de prestations, lorsqu’un tel minimum est prévu au marché (CMP 2006, art. 77, III). Cette possibilité n’a cependant pas été reconduite suite à la réforme du droit des marchés publics.
Par ailleurs, en matière de travaux, un marché public de maîtrise d’œuvre peut être mise en place. Ce marché a pour objet de confier les études nécessaires à l’élaboration du programme et à la détermination de l’enveloppe prévisionnelle de travaux (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 90 ; Loi MOP du 12 juil. 1985, art. 7 ; D. n° 93-1268, 29 nov. 1993, relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé).
2.2. Risques contentieux à prendre en considération dans la définition des besoins
2.2.1. Manquements à l’obligation de définition de la nature et de l’étendue des besoins
Constituent des manquements à l’obligation de définition de la nature et de l’étendue des besoins :
- le défaut d’indication sur les quantités (CE, 24 oct. 2008, n° 313600, Communauté d’agglomération de l’Artois : JurisData n° 2008-074359) ;
- les informations erronées sur les quantités (CE, 12 mars 2012, n° 354355, Dynacité , Sté Dalkia France et a. : JurisData n° 2012-004227 ; CE, 20 févr. 2013, n° 363244, sté American Express Voyages :JurisData n° 2013-003239) ;
- l’imprécision sur la méthode de choix des offres (CE, 10 nov. 2010, n° 340944 , Établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) : JurisData n° 2010-020831) ;
- les informations inexactes données aux candidats (CE, 12 mars 2012, n° 354355, 354356, 354357, 354358, Dynacité , Société Dalkia France : JurisData n° 2012-004227) ;
- l’absence d’informations sur la durée du marché, que les candidats doivent fixer eux– mêmes dans leurs offres (CE, 1er juin 2011, n° 345649 , Commune de Saint Benoît : JurisData n° 2011-010579) ;
- le défaut d’information sur les obligations de reprise du personnel (sans qu’y fasse obstacle l’obligation de respect du secret des affaires) (CE, 19 janv. 2011, n° 340773, Sté TEP ; CE, 1er mars 2012, n° 354159, Dpt de la Corse du Sud : JurisData n° 2012-003068) ;
- les contradictions entre les pièces du dossier de consultation sur la nature du besoin, même si une des pièces n’a pas de valeur contraignante (CE, 23 nov. 2011, n° 350519, Dpt des Bouches-du-Rhône : JurisData n° 2011-026006).
- la surestimation des quantités du marché (CE, 29 juill. 1998, n° 190452 : JurisData n° 1998-050696) ;
- le renvoi de la définition de certains besoins à un dispositif ultérieur (CE, 8 août 2008, n° 307143 : JurisData n° 2008-074047) ;
- la possibilité pour les candidats de proposer des services annexes non définis (CE, 15 déc. 2008, n° 310380 : JurisData n° 2008-074760) ;
- l’absence d’informations relatives à la date d’achèvement du marché dans les documents de la consultation (CE, 1er juin 2011, n° 345649 : JurisData n° 2011-010579) ;
- L’absence d’encadrement suffisamment précis et complet des prestations proposées en faisant largement reposer l’évaluation de leur étendue sur une visite des locaux et la propre évaluation des besoins par les candidats (CAA Douai, 17 janv. 2013, n° 12DA00780 : JurisData n° 2013-006096).Le juge des référés précontractuels exerce, à ce titre, un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 2 oct. 2013, n° 368846, Dpt de l’Oise : JurisData n° 2013-021358).
2.2.2. Risques liés à une mauvaise détermination des besoins
Il existe un risque de dépassement de seuil :
- lorsque la personne publique lance une procédure adaptée et ne recueille que des offres supérieures aux seuils de l’appel d’offres. Elle devra alors déclarer la procédure sans suite et la relancer sous la forme appropriée ;
- lorsqu’en cours d’exécution du marché, un avenant fait passer le montant d’un marché conclu en procédure adaptée au-delà des seuils de l’appel d’offres.
Une mauvaise estimation des besoins peut également constituer un risque de fractionnement irrégulier et révéler de la part du pouvoir adjudicateur une volonté d’échapper aux procédures de mise en concurrence par un découpage artificiel du marché.
Attention : Le conseil doit signaler à la personne publique les risques liés à un fractionnement d’un marché :
- possible annulation contentieuse des marchés considérés ;
- possible mis en débet du comptable public ;
- possible sanction de l’ordonnateur ;
- possible sanction pénale au titre du délit de favoritisme.
Enfin, le risque de voir un avenant déclaré illégal n’est pas négligeable, dans la mesure où le juge peut tirer l’illégalité d’un avenant d’une carence de l’Administration dans la définition de ses besoins.
Exemple : Un avenant à un marché de travaux qui augmente le prix initial de 33 % et modifie substantiellement la nature des travaux à réaliser ne peut être justifié par des sujétions techniques imprévues, dès lors que la collectivité s’est abstenue de procéder, avant l’appel à la concurrence, à un sondage exact et aux études de sol précises exigées par les règles de l’art (TA Paris, 4 avr. 2000, n° 9915308/6, Préfet de Paris).
Un avenant à un marché de travaux qui augmente le prix initial de plus de 60 % et modifie substantiellement la nature des travaux à réaliser ne peut être justifié par des sujétions techniques imprévues, dès lors qu’il s’agit de difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution du marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties (CE, 30 juil. 2003, Commune de Lens, n° 223445 : JurisData n° 2003-065732).
La modification d’un marché public en cours de validité peut être considérée comme substantielle et ne peut donc être effectuée par avenant sans publicité, ni mise en concurrence :
- lorsqu’elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient permis l’admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue (CJCE, 19 juin 2008, aff. C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, pt 35) ;
- lorsqu’elle étend le marché, dans une mesure importante, à des services non initialement prévus (CJCE, 19 juin 2008, aff. C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH , pt 36) ;
- lorsqu’elle change l’équilibre économique du contrat en faveur de l’adjudicataire du marché, d’une manière qui n’était pas prévue dans les termes du marché initial (CJCE, 19 juin 2008, aff. C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, pt 37).
Des avenants à un marché de maîtrise d’œuvre ainsi qu’à un marché de contrôle technique augmentant respectivement leur montant de 63 % et 56 % ne sont pas justifiés, dès lors que les prestations supplémentaires en cause ne présentent pas le caractère de sujétions techniques imprévues, mais résultent d’éléments provenant de demandes de personnes extérieures au contrat, non prises en compte dans le cadre de la préparation du marché (CAA Douai, 17 mai 2000, n° 98DA01231 : JurisData n° 2000-149432).
Mise en œuvre : Identification des types de besoins
Il résulte des termes de l’article 30 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics que le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser.
À ce titre, pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer, notamment dans le cadre d’une procédure de passation formalisée ne permettant pas de négociation avec le pouvoir adjudicateur, d’informations relatives à la date d’achèvement du marché. Si le pouvoir adjudicateur entend laisser aux candidats la faculté de proposer eux-mêmes une date précise d’achèvement, il lui revient alors d’encadrer cette faculté, en fixant par exemple une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l’échéance du marché, sans que, compte tenu des critères de sélection des offres, il en résulte une incertitude telle qu’elle ne permette pas aux candidats de présenter utilement une offre (CE, 1er juin 2011, n° 345649 : JurisData n° 2011-010579).
Les besoins de la personne publique doivent être définis en tant que besoins fonctionnels, ainsi que selon la nature des prestations envisagées (travaux, fournitures, services).
Des marchés peuvent également confier à un cocontractant la réalisation de plusieurs prestations (travaux, services, fournitures), relevant chacune de la notion de marché.
1.1. Marchés publics de travaux
Un marché public de travaux porte sur des travaux immobiliers (à la différence du marché de fournitures), et a pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d’une personne publique exerçant la maîtrise d’ouvrage (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 5 I).
Par travail immobilier, il faut comprendre :
- la construction de l’immeuble ;
- les préliminaires à la construction (travaux de déblaiement, de nivellement, etc.) ;
- le transport des matériaux nécessaires à l’exécution des travaux ;
- les travaux d’entretien et de réparation des immeubles (goudronnage des routes, etc.).
Pour illustrer la notion de « travaux de bâtiment », on pourrait se reporter à une circulaire du 3 mai 1988 , qui intègre les bâtiments et les travaux qui leur sont accessoires, tels que (V. également, PE et Cons. UE, dir. 2014/24/UE, 26 févr. 2016, ann. 1) :
- les ouvrages de voirie et les réseaux divers dont l’usage est la desserte privative du bâtiment ;
- les parkings souterrains lorsqu’ils peuvent être considérés comme les accessoires d’un bâtiment ;
- les chaufferies centrales ;
- les stations de chauffage et les canalisations de transport de chaleur d’un groupe d’immeubles reliés à une chaufferie ou à une station, etc.
Les travaux de bâtiment pourraient être définis comme étant ceux « dont l’objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l’intérieur desquelles l’homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs » (A. intermin. 17 nov. 1978 : JO 21 nov. 1978. – annulé pour incompétence par le Conseil d’État).
En matière de travaux de génie civil, une liste illustrative a été dressée par une circulaire (Circ. n° 96-5, 10 avr. 1996).
1.2. Marchés publics de services
Certaines catégories de services sont soumises, quel que soit leur montant, à la procédure adaptée (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 27), en ce qui concerne la procédure de passation du marché (décr. Art. 28) : il s’agit des marchés ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal Officiel de la République française. Les marchés publics de services juridiques de représentation sont quant à eux exclus de l’application du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Par ailleurs, l’ordonnance relative aux marchés publics précise que ses dispositions ne sont pas applicables à certains types de marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 14 : services de recherche et développement, services relatifs à l’arbitrage et à la conciliation, services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro, certains services juridiques, certains services postaux, etc.), ou passés par les entités adjudicatrices (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 15 : services relatifs aux temps de diffusion).
1.3. Marchés publics de fournitures
Il s’agit des marchés par lesquels la personne publique se procure des produits ou biens mobilisés par l’intermédiaire d’un fournisseur privé.
On distingue :
- les fournitures courantes, qui se trouvent dans le commerce, et parmi lesquelles il faut aussi inclure les marchandises volatiles comme l’eau, le gaz ou l’électricité ;
- les fournitures non courantes, que le fournisseur élabore pour le compte de la personne publique et qui sont livrées clé en main à la personne publique.
1.4. Marchés composites ou mixtes
Ce sont les marchés qui confient au cocontractant la réalisation de plusieurs prestations :
- marché de travaux et de fournitures : marché d’exploitation d’installations de chauffage (travaux d’installation et fourniture du combustible) ;
- marché de services et de fournitures : marché informatique (fourniture de matériels et prestations de maintenance) ;
- marché de services et de travaux : marché de traitement des déchets (prestations de maintenance et réalisation de travaux d’entretien).
Afin de déterminer la nature du marché, lorsque celui-ci inclut la réalisation de travaux, il convient d’identifier son objet principal et ses prestations accessoires : il s’agit d’un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. Il en va différemment lorsqu’un marché public porte à la fois sur des services et des fournitures, sans comporter de travaux : il convient dans ce cas de prendre en compte leur valeur respective pour déterminer la nature du marché, et il s’agira donc d’un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 5 IV).
En principe, l’identification de l’objet s’effectue de manière quantitative en s’attachant aux valeurs respectives de chaque type de prestations.
Les prestations objet du marché doivent être définies dans les documents de la consultation par des spécifications techniques, qui sont des prescriptions techniques décrivant les caractéristiques requises du produit ou du service (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 6 à 9).
2.1. Deux modes de formulation des spécifications techniques
2.1.1. Formulation par référence à des normes publiques ou d’autres documents équivalents
Cette formulation peut être effectuée par référence à des normes publiques ou d’autres documents équivalents (agréments, référentiels techniques européens type CE, ISO, AFNOR).
La référence à une norme ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte à la liberté d’accès aux marchés publics : ainsi, il ne peut être fait mention d’un procédé de fabrication particulier, d’une provenance, d’une marque ou d’un brevet, sauf si cette mention est justifiée par l’objet du marché ou est précédée de la mention « ou équivalent » (CE, 11 sept. 2006, no 257545, Cne de Saran c/ Sté Gallaud : JurisData n° 2006-070778 ; Contrats-Marchés publ. 2006, comm. 286, obs. Pietri). Par exemple, en ce qui concerne la fourniture de vêtements chauds, la personne publique devra écrire « vêtements utilisant la technologie Gore-Tex ou équivalent ».
Plus précisément, le juge administratif contrôle « si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l’hypothèse seulement d’une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l’objet du marché ou, si tel n’est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle » (CE, 30 sept. 2011, n° 350431 , Région Picardie : JurisData n° 2011-020388).
Par ailleurs, afin de ne pas méconnaître les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination ainsi que l’obligation de transparence, le pouvoir adjudicateur ne peut pas modifier les spécifications techniques par référence à un produit d’une marque déterminée après la publication de l’avis de publicité (CJUE, 16 avr. 2015, aff. C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL).
- également :décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation et arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres.
2.1.2. Formulation en termes de performance ou d’exigences fonctionnelles
Les spécifications techniques peuvent également être formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles (niveaux de qualité), lesquelles doivent être suffisamment précises et peuvent inclure des caractéristiques environnementales, en se référant par exemple à un écolabel.
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, précise à cet égard que l’acheteur peut, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier permettant de prouver que les prestations correspondent aux caractéristiques requises (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 10), ou un rapport d’essai ou certificat d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art.11).
Remarque : Il s’agit d’un bon mode de formulation des besoins qui permet de laisser l’opérateur libre de proposer une méthode de son choix pour parvenir au résultat le plus efficient.
Le pouvoir adjudicateur peut combiner les deux modes de formulation des spécifications techniques dans les conditions de l’article 6, II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
2.2. Options et variantes
2.2.1. Options
Les options sont des prestations complémentaires qui doivent être limitées, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence.
L’option est une demande de la personne publique.
Elle doit être renseignée et chiffrée dans l’offre ainsi que lors de l’attribution.
La personne publique a la possibilité de retenir ou non l’option.
Exemple : V. Fiche Question / Réponse DAJ « Conseil aux acheteurs, Options et prestations supplémentaires éventuelle ».
Si l’objet du marché est la rénovation d’un pont, l’option peut porter sur le prolongement de celui-ci par un chemin piéton.
2.2.2. Variantes
La variante est une modification à l’initiative du candidat de certaines spécifications des prestations décrites dans les documents de consultation.
Les variantes sont interdites, sauf mention contraire, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt pour les marchés passés selon une procédure formalisée par un pouvoir adjudicateur ; elles sont en revanche autorisées, sauf mention contraire, dans l’avis de marché ou dans les documents de la consultation pour les marchés passés selon une procédure formalisée par une entité adjudicatrice et pour les marchés passés selon une procédure adaptée (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 58 ). En outre, l’acheteur peut exiger la présentation de variantes.
Outils
- Check-list
- Quelle est la nature des besoins de mon client ?
-
- services ?
- fournitures ?
- travaux ?
- mixte/composite ?
- Quel est le montant des besoins de mon client (à corréler avec les seuils) ?
- Quelle est la fréquence des besoins de mon client ?
- Mon client a-t-il suffisamment d’informations à sa disposition pour être capable de procéder à une bonne évaluation de ses besoins ?
S'abonner à la Newsletter LexisNexis
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires