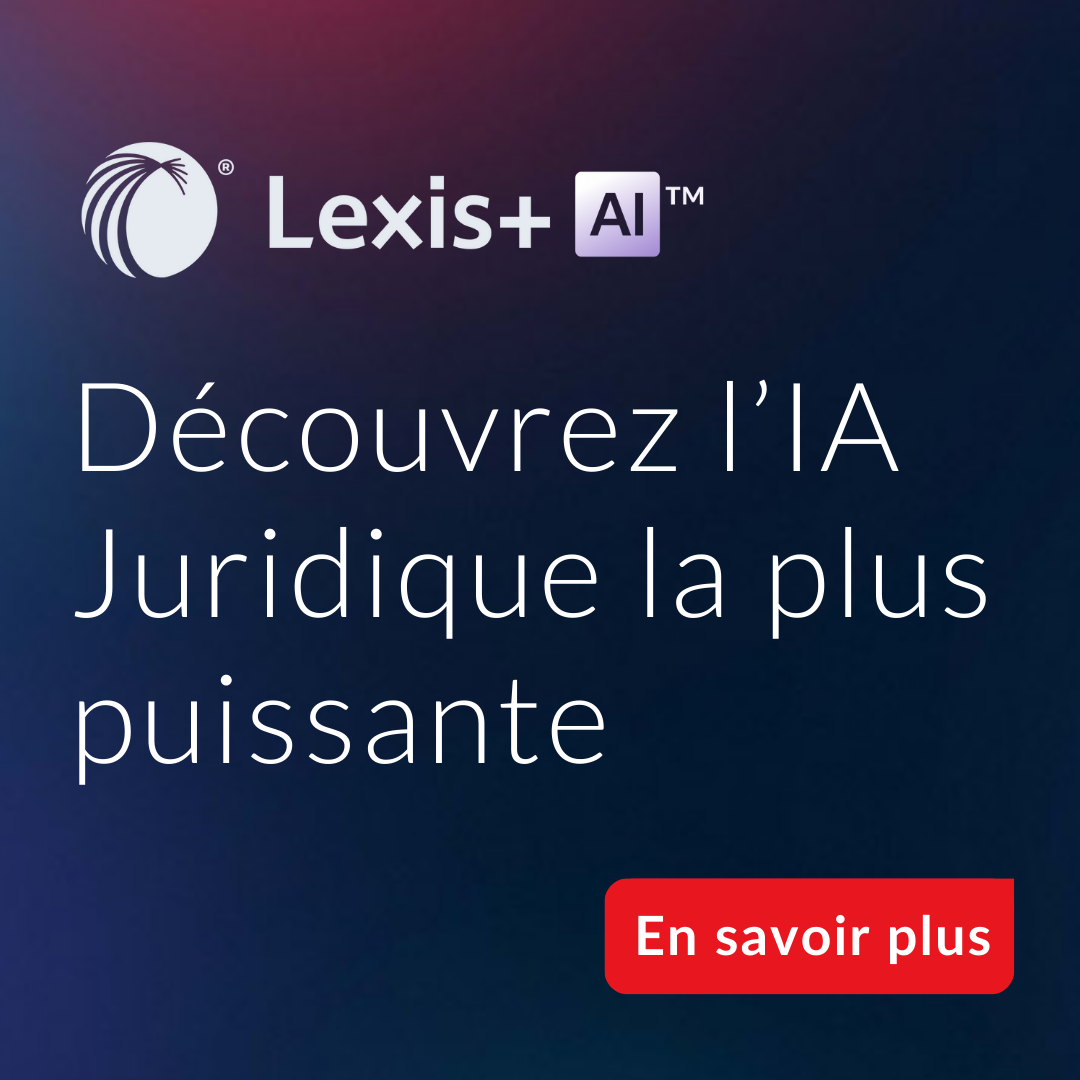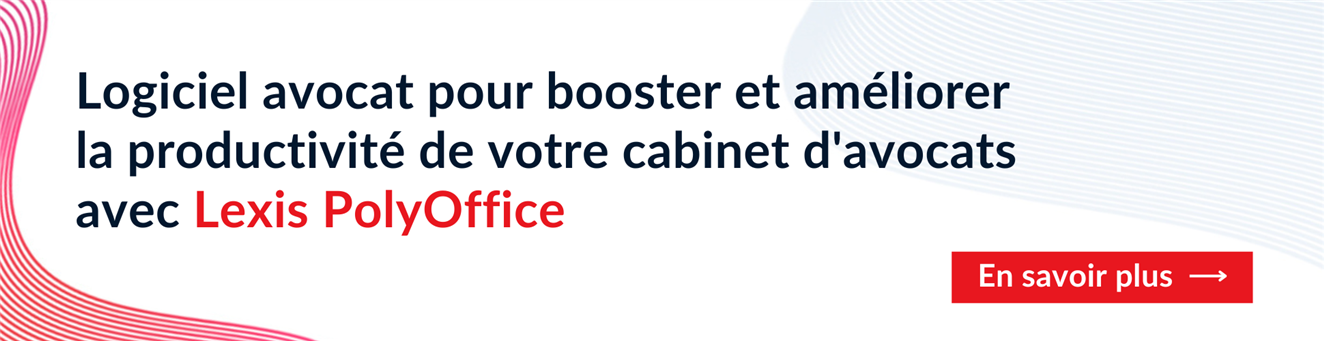L’étude du droit exige de choisir un Code civil fiable, pertinent et à jour . Face à une offre variée, comment bien choisir ? Le Code civil est un partenaire de réussite , un allié qui vous accompagne...
Loi Narcotrafic – Addendums Codes Pénal et de Procédure Pénale La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, dite Loi Narcotrafic , est parue au JO le 14 juin...
Avec l’essor du numérique, la pratique du droit a profondément changé. Pour les professionnels du droit, intégrer de nouvelles notions et outils au sein de leur expertise n’est plus une option, c’est une...
L’ intelligence artificielle (IA) est devenue un sujet central dans le débat public et professionnel, oscillant entre fascination et inquiétude, surtout depuis l’apparition de ChatGPT en 2022. L’ IA générative...
Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre nouvelle boutique en ligne LexisNexis, une nouvelle plateforme qui vous offre une expérience d’achat optimisée, une navigation plus fluide et...
Magistrate exceptionnelle à tous égards, première à répétition : présidente du tribunal de Paris, directrice d'administration centrale et première présidente de la Cour de Cassation. À 103 ans, Simone Rozès est l'une des figures de l'exposition « Justice : les pionnières », inaugurée à la Cour de cassation le 13 avril dernier.
Le procureur de Nevers qui l’accueille pour son premier poste lui précise qu’elle ne doit pas s’attendre à être traitée comme une femme. Elle répond : « comme un collègue, cela ira très bien ». Elle revient à Paris en tant qu’adjointe du bureau du cabinet du garde des Sceaux. Mais après 12 années, lorsqu’il s’agit de remplacer le numéro 1, le ministre tranche : « une femme, vous n’y pensez pas ! ».
Simone Ludwig naît le 29 mars 1920. Après des études de droit, elle dit « avoir la flamme » pour la magistrature. Dès que la loi du 11 avril 1946 permet à l’un et l’autre sexe de rendre la justice, elle se présente aux portes du palais. Son parcours sera exemplaire.
Première présidente de la 17e chambre correctionnelle (1969-1973). Simone Rozès rejoint le TGI de Paris en 1962, où elle est la première femme à présider la chambre correctionnelle dédiée aux affaires de presse. Elle se fait remarquer pour son intelligence, sa liberté de ton et son sens de la répartie.
Première directrice d’administration centrale (1973-1976). Le garde des Sceaux, qui face à une crise à l’éducation surveillée, ancêtre de la protection judiciaire de la jeunesse, pense à Simone Rozès, qu’il décide de nommer directrice, la première en administration centrale à la Chancellerie. Un observateur commente : « ce poste convient à une femme car les maisons de l’éducation surveillée sont des sortes de jardins d’enfants, permettant ainsi à la vocation maternelle de s’épanouir ».
Première présidente du TGI de Paris (1976- 1981). À 56 ans, Simone Rozès est la première femme nommée présidente du tribunal de grande instance de Paris. Elle tient elle-même les audiences de référé. Un jour, elle refuse au ministre de la Justice l’insertion d’un droit de réponse dans un journal. Furieux, Alain Peyrefitte lui téléphone pour lui indiquer que huit personnes lui avaient affirmé que ce dossier tenait. Elle répond : « Monsieur, il s’agissait de huit courtisans ». Elle est priée de quitter son poste et de s’éloigner.
Première femme nommée à la Cour de justice des Communautés européennes (1981-1984). Pendant trois années elle tient le rôle d’avocate générale à la Cour de justice du Luxembourg. Simone Rozès fait de cette promotion-sanction une opportunité et s’inscrit dans l’histoire d’un droit européen.
Première première présidente de la Cour de cassation (1984–1988). François Mitterrand et Robert Badinter ont connu Simone Rozès à la 17e chambre, le premier en tant que prévenu, le second en qualité d’avocat. Devenus respectivement président de la République et garde des Sceaux, ils lui proposent de devenir la première présidente de la Cour de cassation. Pour la convaincre, ils argumentent sur le terrain du symbole paritaire : « vous le devez aux femmes ».
À 64 ans, elle a pour mission de réformer la Cour de cassation, institution considérée comme excessivement traditionnelle. Avec détermination et méthode, elle entame une modernisation de la Haute Cour. En 1988, Simone Rozès quitte la Cour de cassation pour prendre sa retraite. Si elle a constaté que son destin était d’être toujours la première, elle tempérait : « toute carrière a besoin de chance ».
Ni un privilège, ni un handicap, Simone Rozès assume sa « condition féminine ». Cette pionnière choisit une approche égalitaire pour présenter l’entrée des femmes dans la magistrature comme simplement normale. Elle évite de mettre en avant les supposées qualités des femmes comme autant de risques de les cantonner à des fonctions « de sensibilité ». Elle insiste sur le fait qu’au cours du délibéré, elle n’a jamais perçu « de différence entre le raisonnement juridique d’un homme ou d’une femme : la compétence est partagée » (V. G. Joly-Coz, Femmes de Justice : Enrick B. éd., 2023).
Recevez les dernières actualités LexisNexis
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires