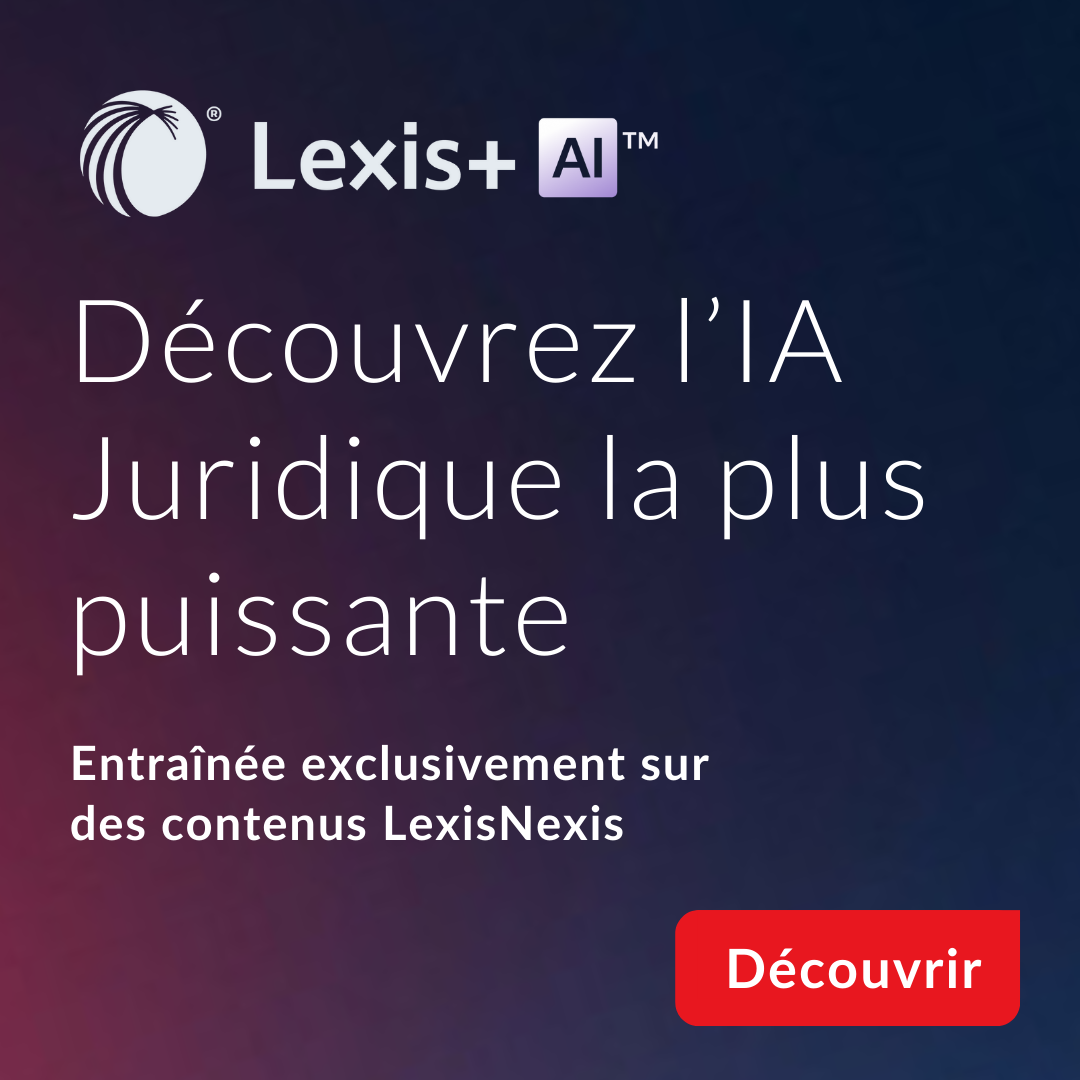La période des fêtes n'en finit pas d'être endeuillée. Station de ski du canton du Valais, Crans-Montana fut le théâtre d'un drame impensable. Chaque Saint-Sylvestre aura désormais le goût de la mort et...
La fin de l’année aura été marquée par la proposition du député RN, Jean-Philippe Tanguy, de rouvrir des maisons closes. À l’en croire, celles-ci s’envisageraient un peu comme des phalanstères du sexe...
À l’heure où la laïcité occupe une place centrale dans le débat public, tout en faisant l’objet de nombreuses approximations, les Éditions LexisNexis publie le premier Code de la laïcité et du fait religieux...
On connaîtra le 16 janvier la décision de la Cour de cassation, sur la prescription du crime reproché à Yves Chatain, qui a avoué en 2022 avoir tué Marie-Thérèse Bonfanti, une livreuse de journaux de 25...
En trois ans à peine, l’intelligence artificielle générative a muté : d’un simple outil d’exécution, elle est devenue une force d’analyse, de synthèse et d’action autonome. Avec l’IA agentique – capable...

Je suis un peu comme mon collègue Nicolas Molfessis (Le trading des migrants : JCP G 2024, act. 1254) : le nouveau ministre de l’Intérieur et son sens des formules, je ne les avais pas vus venir. Mais ce qui était plus prévisible, c’est le contenu desdites formules. Exemple : l’État de droit qui ne serait ni sacré ni intangible, voilà qui est bien dans l’air du temps. Du moins chez certains. Prenez le dernier essai de Marcel Gauchet (Le noeud democratique : Gallimard, 2024). Celui-ci y soutient en substance que la démocratie telle que les modernes la conçoivent repose sur un équilibre entre le pouvoir des citoyens érigés en corps à travers l’élection (sa composante « démocratique »), et les libertés personnelles qu’elle garantit via l’action des juges (sa composante « libérale »). Or cet équilibre serait rompu au profit d’une hypertrophie des libertés qui placerait le juge au centre du jeu tout en faisant la part belle aux minorités au détriment du corps des citoyens. Ce qui revient d’abord à dire que la démocratie est remise en cause de l’intérieur. Ce qui permet ensuite de donner une explication à un très actuel choc en retour : « l’idéal libéral tend à devenir antidémocratique, ce qui suscite une remobilisation de l’idéal démocratique qui tend à le rendre illibéral ».
De là, deux façons d’interpréter les propos du ministre de l’Intérieur : soit retenir qu’ils inscrivent leur auteur dans ce courant illibéral, soit soutenir qu’ils en font le défenseur de la démocratie des modernes contre cet illibéralisme. Accorder un peu moins de place aux libertés des minorités pour conférer plus de pouvoir au corps des citoyens revient en effet à rétablir ce fameux équilibre entre les deux composantes de la démocratie.
En me lisant, j’imagine que vous doutez de la pertinence de ma seconde interprétation qui suppose d’adhérer à la thèse de Marcel Gauchet. Elle pourrait néanmoins avoir sous-tendu le propos des défenseurs du ministre quand ils ont avancé que celui-ci avait confondu État de droit et état du droit. Il faudrait ainsi changer celui-ci pour retourner à l’équilibre précité.
Admettons. Mais se poserait alors toute une série de questions : que changer de cet état ? Comment identifier les prétendues minorités à l’origine du déséquilibre ? Sur quelles libertés revenir ? Et dans quelle mesure ? L’exercice paraît redoutable. S’en prendre alors aux juges qui seraient à l’origine du problème ? Mais ne serait-ce pas se tromper en partie de cible, ceux-ci ne faisant bien souvent qu’appliquer les textes votés par le corps du peuple ou ses représentants ? Et comment s’en prendre à eux ? En contestant leur indépendance ? En revenant sur leurs modes de nomination ?
En outre, modifier l’état du droit présente un autre écueil que « la tribu juridique » (Marcel Gauchet) ne cesse de dénoncer : on ne peut modifier le droit qu’en en produisant à son tour. Or un membre éminent de la tribu vient de l’écrire : la production de normes juridiques est elle aussi susceptible de porter atteinte à la démocratie (J.-D. Combrexelle, Les Normes a l’assaut de la democratie : Odile Jacob, 2024).
Décidément, on ne s’en sort pas ! Aussi, lorsqu’on exerce un ministère, mieux vaudrait se méfier des formules. Quand elles ne sont pas dépourvues de sens, on prend le risque de les rendre inopérantes ou dangereuses.
Edito à retrouver dans la Semaine Juridique Edition Générale #45
S'abonner à la Newsletter LexisNexis
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires