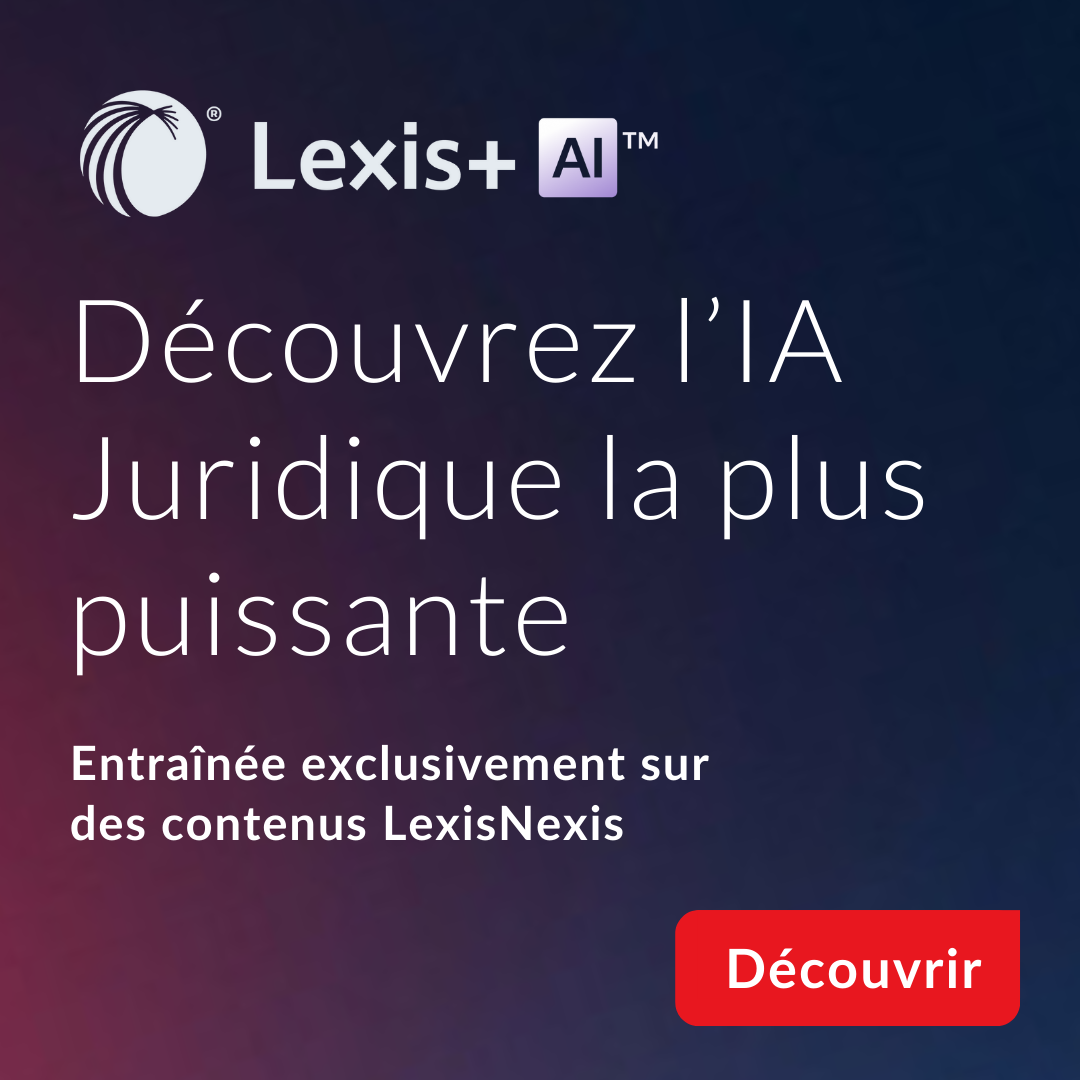L’IA juridique rencontre l’IA générale : l’intégration sûre et maîtrisée dans Lexis+ AI Alors que les professionnels du droit adoptent massivement l’intelligence artificielle pour la recherche et la...
Le 6 novembre dernier, le Sénat a rejeté la proposition de loi constitutionnelle déposée par le sénateur socialiste Éric Kerrouche. Le texte débattu visait à protéger la Constitution en interdisant sa...
Paris Place de Droit organise en décembre le premier événement réunissant les acteurs de l’écosystème du contentieux des affaires. Pourquoi un tel événement ? Cette année, Paris Place de Droit fête ses...
Le passage obligatoire à la facturation électronique pour toutes les entreprises en France approche à grands pas. S'y préparer dès maintenant n’est pas seulement une question de conformité légale , c’est...
La réforme de la facturation électronique est sur le point de transformer la gestion des entreprises en France. Pour vous y préparer au mieux et réussir votre transition, vous devez connaître les dates...

« Les cours criminelles doivent être supprimées », affirmait un collectif d'avocats, de magistrats et d'associations féministes dans une tribune publiée le 18 mars dans Le Monde. Selon les autrices et les auteurs du texte, fervents partisans des cours d'assises et du jury populaire, ces juridictions généralisées en 2023, ne remplissent pas les missions qui ont justifié leur création, à savoir des délais de justice plus rapides et une moindre correctionnalisation de certains crimes, principalement les viols. Un constat en partie partagé par le procureur général Rémi Heitz: « Dans le contexte de forte attention portée à la répression des crimes sexuels, la récente création des cours criminelles a contribué à accroître la charge des juridictions criminelles et aggravé la pression des délais», relevait-il le 10 janvier à l'occasion de la rentrée solennelle de la Cour de cassation. Autre reproche formulé par leurs adversaires, ces cours auraient un taux d'appel au moins égal, voire supérieur, à celui des cours d'assises.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé de se pencher sur la question en lançant une mission d'évaluation. Parmi les personnalités dont elle a sollicité les avis, figurent les deux avocats de Gisèle Pelicot, Stéphane Babonneau et Antoine Camus. Les parlementaires ont également prévu de recueillir celui de la juge Aude Buresi, qui préside depuis le 24 février et jusqu'à début juin, le procès de l'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec, poursuivi pour 299 viols et agressions sexuelles devant la cour criminelle du Morbihan, à Vannes. Gageons que leur témoignage fera pencher la balance dans un sens bien plus favorable à ces nouvelles juridictions, uniquement composées de magistrats professionnels.
Le procès Mazan, qui s'est achevé le 19 décembre, constituait l'épreuve du feu : trois mois et demi d'une audience particulièrement éprouvante, cinquante accusés (le cinquante-et-unième était en fuite), des débuts d'autant plus laborieux que le label « grand procès » lui avait été refusé, le tout sous la pression quotidienne de l'opinion publique nationale et internationale. Au bout du compte, la cour criminelle du Vaucluse a rendu un verdict exemplaire, tant par sa netteté - tous les accusés ont été déclarés coupables - que par les nuances apportées à l'échelle des peines prononcées. À l'exception de Dominique Pelicot, condamné à la sanction maximale, vingt ans assortis de deux tiers de sûreté, toutes les peines ont été largement inférieures à celles requises, de trois ans partiellement assortis du sursis à quinze ans.
Une cour majoritairement composée de jurés citoyens serait-elle parvenue au même travail de dentellière que les cinq juges professionnels du procès Mazan ? Aurait-elle su, et pu, s'affranchir autant qu'eux, du fracas extérieur exigeant « 20 ans pour tous » et d'un réquisitoire aussi peu subtil que convenu fixant une peine plancher de 10 ans ?
Le calme qui avait suivi l'annonce du verdict donnait déjà la mesure du tour de force accompli par les juges. La suite les conforte. Sur les cinquante-et-un accusés, plus des deux tiers plaidaient l'acquittement. Seuls dix-sept d'entre eux ont interjeté appel. Depuis, les désistements se sont multipliés. Ils ne sont aujourd'*** plus que cinq et il est probable que ce chiffre s'amenuise encore, à l'approche de l'audience prévue fin 2025 devant la cour d'assises d'appel du Gard, à Nîmes. Aura-t-elle même lieu ? Par son verdict, le procès des viols de Mazan est devenu l'appartement-témoin de la cour criminelle.
Edito à retrouver dans la Semaine Juridique Edition Générale #18
S'abonner à la Newsletter LexisNexis
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires